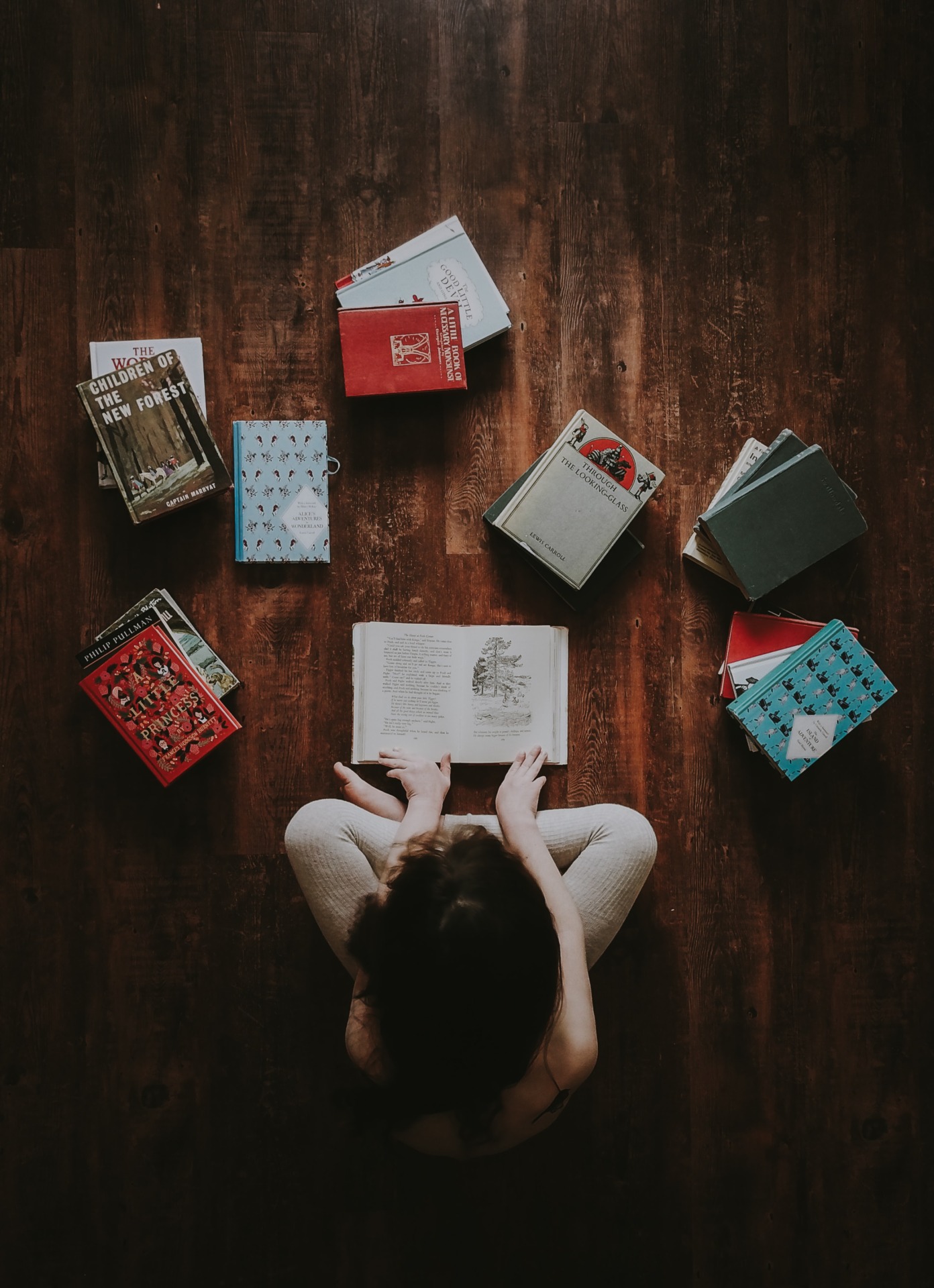Les erreurs ont une connotation fortement négative. L’erreur, c’est quelque chose de mauvais, de répréhensible et de honteux. Dans cet article, je souhaite combattre cette idée et voir comment mettre à profit nos erreurs.
Selon le Larousse, une erreur est « une chose fausse, erronée par rapport à la vérité, à une norme, à une règle ». Je ne suis pas d’accord. La règle dit que « y a rien » n’est pas correct, c’est une erreur. Qu’un élève l’écrive sur sa copie et le professeur le soulignera en rouge, corrigera « il n’y a rien ». Pourtant, tout le monde parle comme ça. Peut-on vraiment dire qu’un usage est fautif si on le retrouve chez l’entièreté de la communauté linguistique ?
Il y a les erreurs condamnée par la norme que même les natifs font. Et il y a les erreurs qui ne sont pas des choses erronées par rapport à une règle, mais plutôt par rapport à un usage.

Dans l’usage, tout le monde dit « y a rien ». Je ne dirais pas que c’est une faute si un étranger le dit lui aussi. Mais si il dit « ça n’y rien », ce serait vraiment une faute : les gens ne parlent pas comme ça habituellement.
Parler de manière naturelle
Il existe en réalité deux types de règles.
Il y a d’un côté les règles de la langue prescrite : la théorie nous dit ce qui est correct ou non dans la langue. Cette théorie nous dit que « y a rien » n’est pas correct, et qu’une phrase comme « les pommes, j’aime pas trop » est une aberration, dixit Madame Durand, prof de français des 3ème B.
Et de l’autre côté, il y a les règles implicites de la langue orale, celles que suivent inconsciemment les gens quand ils parlent naturellement. Et quand ils parlent naturellement, la double négation disparaît, c’est une règle quasi systématique, et on retrouve couramment une structure dite de désarticulation par la gauche (mettre l’objet avant le sujet et le verbe : « les pommes, j’aime pas trop »).
Donc, on a d’un côté les règles prescrites (comment les profs de français voudraient qu’on parle) et d’un autre côté les règles observées (qui décrivent comment on parle vraiment).
Bien sûr, il faut connaître un minimum les règles prescrites, surtout si on veut écrire des textes sérieux dans la langue que l’on apprend. Mais je pense qu’il faut savoir aussi s’en affranchir si on veut parler comme les gens parlent réellement. Dans un contexte communicationnel, connaître la langue réelle permet de comprendre ce que disent les gens et de parler de manière naturelle.
Nos erreurs ne sont pas aléatoires
« Je fais toujours cette erreur », vous avez sans doute déjà prononcé cette phrase. En fait, nous répétons toujours les mêmes schémas fautifs. Nos erreurs sont extrêmement régulières. Leur régularité tient du fait qu’elles aient une origine logique : elles sont des traces des langues que nous connaissons, autrement dit, des interférences.
Un exemple. Les anglophones apprenant le français ont tendance à faire la même erreur lorsqu’ils se présentent : « Je suis dix-sept ans ». C’est un calque direct de l’anglais ; et les Français débutants font précisément la même erreur dans le sens inverse, « I have seventeen years old ».
Ces exemples sont assez caricaturaux, mais il en va de même avec la plupart des erreurs que l’on fait dans une langue étrangère : elles viennent de calques peu judicieux d’une langue sur une autre. Une erreur plus subtile serait par exemple qu’un anglophone demande à quelqu’un d’attendre ainsi : « juste un moment » (« just a moment »). En français, on préfèrera « un instant », ou « une minute ».
Apprendre une nouvelle langue, c’est construire notre connaissance d’un nouveau système ; pour ce faire, on s’appuie sur les structures que nous connaissons déjà, on les applique inconsciemment à la langue apprise – et c’est ainsi que se créent les erreurs.
Si un trait grammatical n’existe pas dans notre langue maternelle, on aura généralement du mal à le maîtriser. Par exemple, les articles (le, la, les, un, une, des) n’existent pas en russe, et c’est souvent difficile pour les russophones de choisir le bon article, quand ils pensent à le mettre. À l’inverse, l’aspect perfectif ou imperfectif du verbe n’existe pas en français, et c’est alors dur pour les francophones de choisir entre un verbe perfectif ou imperfectif en russe. Dans ce cas, il ne s’agit pas de calques, mais de choix plus ou moins aléatoires…
Bien sûr, les erreurs peuvent venir aussi du fait qu’un apprenant ne connaisse pas une règle ou ne la maîtrise pas encore assez bien. Si un étranger ne met jamais de E aux adjectifs féminins, cela ne signifie pas nécessairement que les adjectifs ne s’accordent pas en genre dans sa langue (quoique cela reste une hypothèse) : peut-être ne connaît-il juste pas la règle d’accord en genre du français.
Ce que les erreurs nous enseignent
Il y a deux conséquences au fait que nos erreurs aient une origine rationnelle.
La première, c’est qu’on peut en apprendre sur la langue d’un apprenant sans même qu’il ne la parle : il suffit d’analyser ses erreurs dans la langue qu’il apprend. Remarquez qu’un lusophone dit « J’aime de faire du sport », et vous pourrez déduire qu’en portugais, on « aime de faire » quelque chose («Eu gosto de fazer…»). Idem pour les anglophones (« I like to do… »).
C’est justement parce que les erreurs sont si régulières que la linguistique contrastive peut comparer des langues à des fins didactiques : en voyant en quoi les langues sont différentes, on peut anticiper les erreurs que feront les apprenants et ainsi mieux leur enseigner la langue seconde.
La deuxième conséquence, c’est que nous pouvons reprogrammer notre esprit pour ne plus faire les mêmes erreurs encore et encore. Si elles sont logiques, elles sont catégorisables, nous pouvons donc comprendre à quelles notions elles se rapportent. Comprendre et retenir une seule règle peut corriger des centaines d’énoncés.
Pour reprendre notre exemple « J’aime de faire du sport », il s’agit d’une erreur liée à une préposition (de). Notre locuteur, appelons-le João, ne s’en rend peut-être pas compte, mais il fait probablement de nombreuses erreurs dans les choix de prépositions, et c’est normal, puisqu’elles sont souvent différentes en portugais et en français :
| Penser à | Pensar em |
| Décider de | Decidir ø |
| Devoir ø | Ter de |
Mais si João se rend compte qu’il a une difficulté avec les prépositions, il peut se pencher sur la question, chercher des listes de verbes français avec les prépositions qu’ils requièrent, apprendre les cas où elles sont différentes d’en portugais… et ainsi corriger de très nombreuses erreurs.
Nos erreurs sont utiles
Nous pouvons beaucoup progresser grâce à nos erreurs. Il faut pour cela ne plus les ignorer, mais les noter, les lister dans un cahier ou un fichier texte, accompagnées de leurs corrections.
Ainsi, on peut peu à peu discerner des catégories : les erreurs liées aux genres des mots, celles liées à la conjugaison, à l’ordre des mots, au choix des prépositions, des temps verbaux, etc. Vous pouvez ainsi créer un tableau de vos erreurs qui vous montre littéralement ce que vous devez améliorer.
Toutes ces catégories seront des points à travailler. En les étudiant, vous surmontez vos erreurs, vous vous surpassez. Mais pour cela, il faut d’abord identifier ses failles.
Savoir être sévère
Il arrive qu’on fasse continuellement une erreur dans une langue étrangère sans le soupçonner : personne n’ose nous le dire. Les adultes n’aiment pas toujours corriger ce que disent les autres, ils peuvent craindre de froisser l’autre, d’être mal vus… alors ils laissent passer. Mais l’indulgence n’aide pas à progresser, elle conforte dans l’erreur.
Pour remédier à vos erreurs, il faut que vous preniez conscience d’elles, et pour cela, il faut que les gens vous disent quand vous vous trompez. Vous pouvez leur demander explicitement de vous reprendre lorsque vous faites une erreur, les rassurer en disant que vous ne le prendrez pas mal, qu’au contraire cela vous aidera. Plus une personne est sévère et plus vous pourrez progresser.
Si vous avez confiance en votre interlocuteur et savez qu’il vous corrigera toujours, vous pouvez même prendre des risques.
Les professeurs de langues encouragent souvent ainsi leurs élèves : « Si la phrase que tu veux dire est compliquée, reformule-la avec d’autres mots, tu arriveras à l’exprimer ». Et c’est très bien : quand on apprend, il faut avoir pour but de réussir à communiquer.
Mais on applique ce principe aussi pour éviter les erreurs. Je veux dire telle phrase mais elle me semble erronée ? Je la transforme, j’en crée une autre qui est safe, où je suis sûre que je ne ferai pas de faute. C’est une stratégie tout à fait normale qui nous permet de rester dans notre zone de confort.
Si vous êtes en mesure d’aller vers l’erreur, de dire cette phrase incorrecte afin d’être corrigé(e), vous obtiendrez la correction, vous apprendrez quelque chose que vous n’auriez pas appris avec votre phrase plus sûre, et vous saurez dire cette chose la prochaine fois.
Sortir ainsi de sa zone de confort est une étape supérieure pour progresser : on peut restreindre nos phrases pour être sûr qu’elles seront correctes, mais pour se surpasser, il faut aussi affronter de face la difficulté et non la contourner. Faites l’erreur, provoquez-la en sachant que vous pouvez compter sur l’autre pour vous corriger. Si vous êtes mal à l’aise à l’idée qu’on juge votre niveau de langue et pense à tort que vous parlez mal, vous pouvez introduire votre phrase : « Comment dire correctement… ? ».
Accueillir l’erreur avec le rire
Les erreurs s’accompagnent souvent de contresens. Reprenons le russe : si en français, on dit « aller à table », en russe, nous disons « s’asseoir derrière la table » («садиться за стол»). Et moi, je ne le savais pas. Alors j’ai calqué le français, tenté un « vas à table » («иди на стол») et… j’ai demandé à mon petit-ami d’aller sur la table. Il a rigolé et m’a demandé si je voulais qu’il y danse, aussi.
Prendre l’erreur avec le rire efface les appréhensions ; on a parfois peur de se ridiculiser devant les locuteurs natifs. N’ayez pas honte de vos erreurs, amusez-vous-en et parler la langue sera plus facile et drôle !
En conclusion, les erreurs sont naturelles, rationnelles et surtout, extrêmement utiles pour progresser. Elles sont d’excellents outils pour nous améliorer, ce sont des flèches directrices qu’il faut prendre le temps de remarquer et exploiter pour progresser toujours plus.