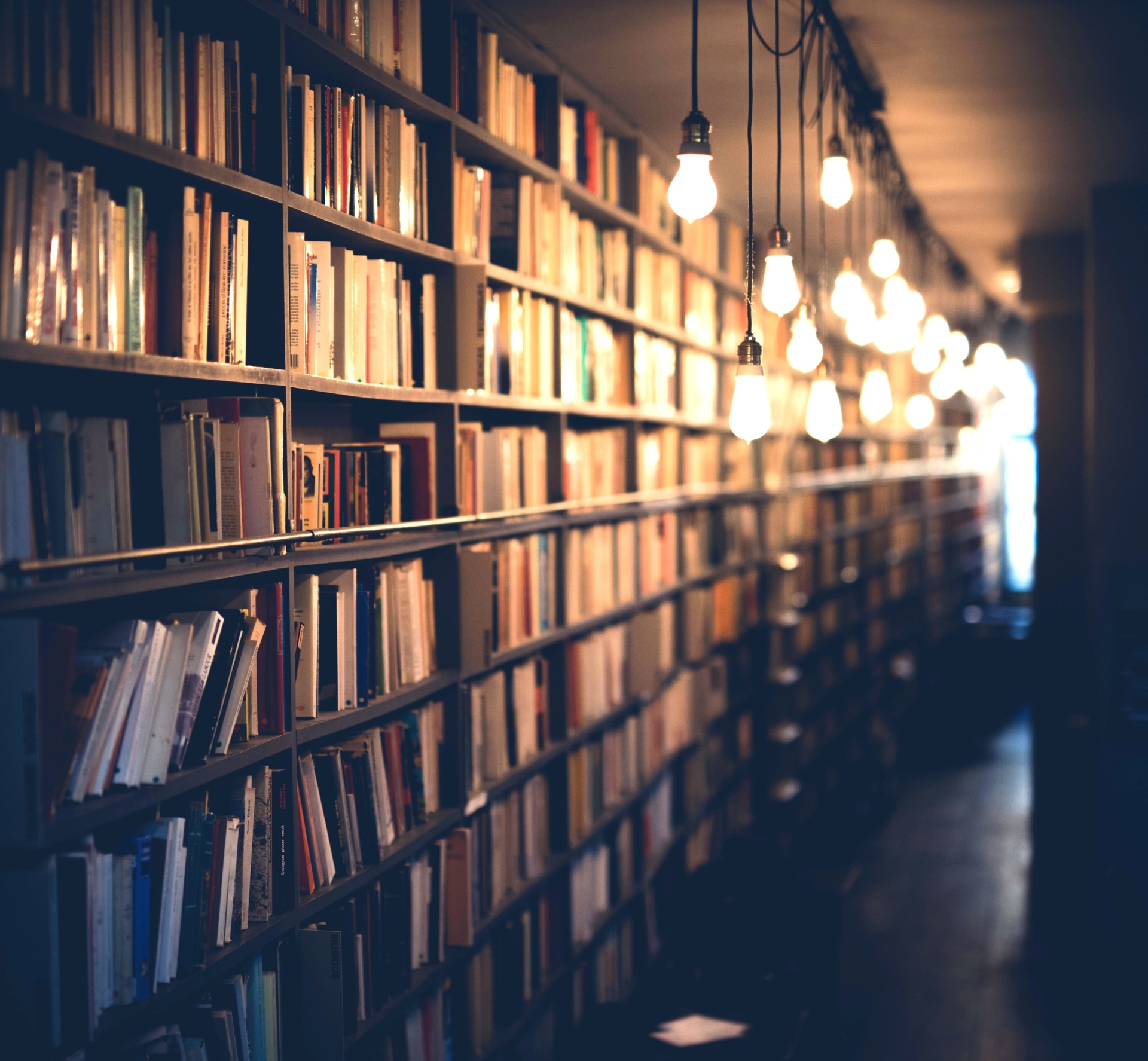Nous savons d’intuition ce qu’il faut retenir lorsque nous apprenons un nouveau mot : comment il s’écrit et ce qu’il veut dire, cela va de soi. Mais ce n’est pas tout.
Les mots sont comme des sacs qui contiennent en eux bon nombre d’informations qu’il faut connaître si l’on veut les maîtriser à 100 %.
Voici lesquelles :
1. L’orthographe du mot
Pour pouvoir l’écrire. D’autant plus important si la langue a une orthographe difficile (comme en français) ou utilise un autre système d’écriture (idéogrammes, abjads).
2. La prononciation du mot
Elle pourrait ne pas correspondre à son orthographe. Apprenez aussi l’accent tonique si votre langue en comprend. Afin de reconnaître le mot à l’oral et de le prononcer correctement, vérifiez toujours la prononciation en cas de doute. Dans l’idéal, entendez toujours les mots que vous apprenez, sans quoi vous pourriez ne pas savoir les prononcer ou les reconnaître à l’oral.
3. Le sens du mot
Ici, c’est plus compliqué.
D’abord, un mot peut avoir plusieurs sens.
Par exemple, une chatte est la femelle du petit félin domestique qui règne sur nous autres humains, mais aussi une partie sensible de l’anatomie féminine. Si un apprenant du français vous informe chastement « J’aime les chattes », votre esprit mal tourné risque de le mettre dans une situation embarrassante. Idem si le pauvre garçon ajoute qu’il adore les chiennes.
Sachez quand un mot a plusieurs sens, c’est-à-dire quand il est polysémique, afin d’éviter les contresens.
Ensuite, il arrive souvent que les mots n’aient pas tout à fait le même sens d’une langue à l’autre.
Par exemple, comment dit-on café en russe ? Кофe, prononcé kofé. Bien. Vous proposez à votre ami Popov d’aller à un café pour boire un coup : Пошли в кофе. Il se met à rigoler. Qu’est-ce que vous avez dit de drôle ? Vous lui avez proposé d’aller dans une tasse de café. Car si la boisson se dit kofé, l’établissement, lui, se dit kafé. On boit du kofé dans un kafé.
Donc, en français, café signifie deux choses : le breuvage et l’endroit. En russe néanmoins, кофе signifie uniquement l’un, et кафе l’autre : les limites sémantiques (= du sens des mots) sont ici plus restreintes en russe qu’en français.
Autre exemple de décalage sémantique : en japonais, magasin et restaurant se disent de la même manière : missé (店). Ne croyez donc pas qu’on vous suggère d’aller faire vos courses dans un restaurant, les limites sémantiques sont juste plus larges : on a deux mots en français, ils en ont un en japonais.
Dernier exemple : en russe, une fille se dit dyévushka (девушка) mais désigne aussi bien une femme de trente ou quarante ans, politesse oblige. Ici, les limites sémantiques sont carrément décalées. Appeler une femme jenshina (женщина, une femme) peut être offensant. Notez l’importance de savoir précisément l’étendue du sens d’un mot afin de ne pas le mésuser.
Prêtez donc attention à la signification précise du mot que vous apprenez pour savoir ce qu’il signifie réellement. Ce mot est-il polysémique ? Sa définition est-elle plus plus large ou plus restreinte que son équivalent dans votre langue maternelle ?
Il serait trop long et difficile de chercher paranoïaquement le sens exact de tous les mots que vous apprenez. Soyez juste sensibles à ces nuances si vous les rencontrez durant votre apprentissage : elles vous permettront de bien connaître et utiliser les mots.
4. Le registre du mot
Quelle différence y a-t-il entre travailler et bosser ? Entre fatigué et courbatu ?
Ces mots ont exactement le même sens. Leur différence est dans le registre : travailler est de registre neutre, tandis que bosser est familier. Fatigué est neutre, courbatu littéraire.
Mélanger les registres crée un effet peu naturel et souvent comique : imaginez lire dans une lettre de motivation : « Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, je souhaite bosser au sein de votre entreprise »… le familier ne va pas dans un contexte formel.
De même, le littéraire cadre difficilement dans un contexte familier : « Putain chuis courbatu » donne à rire.
Ces décalages de registres, on les évite naturellement dans notre langue maternelle. Mais pour les éviter dans une langue étrangère, il faut d’abord avoir conscience de ces niveaux de langage. Lorsque vous apprenez un mot nouveau, dans le doute, cherchez dans un dictionnaire ou demandez à un natif : ce mot est-il familier ? Vulgaire ? Neutre ? Formel ? Littéraire ? Vieilli ? Scientifique ? Vous éviterez ainsi de parler de manière peu naturelle en employant des mots d’un registre que vous ne soupçonniez pas.
5. Le verbe : transitif ou intransitif ?
« J’ai tombé mon livre ! ». Pas correct. Pourquoi ? On dit bien « j’ai pris mon livre », « j’ai lancé mon livre », « j’ai brûlé mon livre », alors pourquoi pas « j’ai tombé » ?
Car on ne peut pas « tomber quelque chose ». Tomber ne peut pas être suivi d’un objet, comme dormir ou courir. On ne peut pas « dormir un enfant » ou « courir un chien » : ces verbes ne peuvent pas avoir d’objet, ils sont dits intransitifs.
Les verbes qui, au contraire, peuvent avoir un objet sont dits transitifs : « bercer un enfant », « promener un chien » se disent ; bercer et promener sont donc transitifs.
Certains verbes sont à la fois transitifs et intransitifs. Prenons le verbe brûler : « j’ai brûlé mon livre », le livre est l’objet, c’est donc un verbe transitif. « Le livre brûle », le livre est le sujet, il n’y a pas d’objet, c’est donc un verbe intransitif.
Autre verbe à la fois transitif et intransitif : commencer. « Je commence l’exposé », transitif. « L’exposé commence », intransitif.
Il est très courant de faire une faute parce qu’on a utilisé un verbe intransitif de manière transitive ou inversement (« j’ai tombé mon livre »). C’est une erreur particulièrement fréquente chez les anglophones qui apprennent le français, les verbes étant souvent labiles dans cette langue (c’est-à-dire à la fois transitifs et intransitifs).
Pour éviter de faire ces erreurs, il faut savoir quels verbes sont transitifs et lesquels sont intransitifs dans votre langue apprise. Cette distinction est omniprésente, du japonais au russe en passant par le portugais. Comparez :
| Commencer (transitif) | Commencer (intransitif) | |
| portugais | Iniciar | Iniciar-se |
| russe | Начинать, nachinat’ | Начинаться, nachinat’sya |
| japonais | 始める, hajimeru | 始まる, hajimaru |
Vérifiez si le verbe que vous apprenez est transitif ou intransitif. Les dictionnaires le précisent toujours, et cette distinction vous aidera à éviter bon nombre d’erreurs.
6. La compatibilité lexicale
La compatibilité lexicale, c’est tout simplement le fait qu’un mot aille bien avec un autre. Par exemple, « une pomme mûre » sonne mieux que « une pomme mature » : on peut dire que le mot pomme a une affinité avec l’adjectif mûre, et qu’il a moins d’affinité avec l’adjectif mature.
Les mots ont donc des affinités lexicales ; de la même manière, ils ont aussi des incompatibilités. « Une pomme extrême » ne veut rien dire, bien que l’association de ces mots soit théoriquement correcte. Les mots pomme et extrême sont tout simplement incompatibles.
Voici d’autres exemples d’incompatibilité :
- Compatibles : Des pensées moroses, des pensées affectueuses, de sombres pensées, d’amères pensées, des pensées bienveillantes…
- Incompatibles : Des pensées urgentes, des pensées salées, des pensées boisées, des pensées contingentes, des pensées piétonnes…
Ces combinaisons créent un conflit mental : elles sont grammaticalement correctes et compréhensibles, mais incohérentes, illogiques. On conçoit difficilement des « pensées contingentes ». On ressent qu’il y a une incompatibilité lexicale entre ces termes. Le bon sens seul nous permet d’éviter ces associations ; on appelle cela la restriction sémantique (le sens limite ces associations).
Ce qui nous intéresse dans la maîtrise d’une langue, c’est surtout l’affinité lexicale, puisque l’incompatibilité est en soi assez intuitive. En linguistique, on parle de collocations. Par principe d’affinité, certains mots appellent naturellement à un épithète (adjectif) qui lui est souvent associé ; non pas qu’il s’agisse des seuls adjectifs que l’on puisse adjoindre à ces noms, mais ces combinaisons sont particulièrement harmonieuses car très courantes :
une idée → brillante
un accord → tacite
des mets → raffinés
un paysage → désolé
une chaleur → suffocante
Ces associations sont plus courantes que « une idée rayonnante », « un accord inexprimé », « des mets subtils », « un paysage désert » ou « une chaleur étouffante », bien qu’ils aient exactement le même sens. Cela vaut pour toutes les catégories grammaticales : quel verbe va bien avec quel nom, quel adverbe avec quel verbe, etc. Par exemple, on préfère « monter un projet » à « faire un projet », et à l’inverse, on préfère « faire une liste » à « monter une liste ». Avec lacune on aime le verbe combler (« combler ses lacunes »), avec autorité on préfère exercer (« exercer une autorité »), avec doute on apprécie semer ou jeter (« semer/jeter le doute »), etc.
Les mots ont leurs propres affinités : les verbes parler, frapper ou aimer vont bien avec l’adverbe fort (« parler fort », « frapper fort », « aimer fort »), mais pas le verbe essayer (*« essayer fort »), qui n’aime pas beaucoup les adverbes d’intensité.
Notez qu’en anglais, on peut dire « to try hard » (littéralement « essayer fort ») : les affinités lexicales sont différentes d’en français.
On peut aussi, comme en français, dire « to hit hard » et « to love hard », néanmoins pour cause de compatibilité lexicale, on ne dira jamais « to speak hard » mais « to speak loud/loudly ». La raison en est que le mot français fort signifie, par polysémie (= plusieurs sens pour un même mot), « intensément » mais aussi « à un volume sonore important ». C’est ce dernier sens que l’anglais hard ne comprend pas et qui rend impossible le calque « to speak hard ». D’où l’importance de connaître le sens précis des mots (point n°3 de cette liste).
Le seul travail du sens précis des mots devrait vous guider afin de les combiner de manière judicieuse. Si vous savez que hard ne signifie pas « fort en volume sonore », vous ne tenterez sans doute pas la combinaison « to speak hard ».
Si vous vous penchez sur le thème des compatibilités et affinités lexicales du vocabulaire que vous apprenez, votre maîtrise de la langue en sera décuplée. Il s’agit là d’une étude poussée de la langue, qui est en soi moins indispensable que son équivalent symétrique : connaître les incompatibilités lexicales.
En résumé
Maîtriser complètement un mot, ça signifie connaître :
1. Son orthographe, son écriture
2. Sa prononciation exacte
3. Sa signification ; son éventuelle polysémie, son sens exact
4. Son registre ; neutre, familier, vulgaire, formel, littéraire, scientifique…
5. Pour un verbe, son aspect transitif ou intransitif
6. Les compatibilités, incompatibilités et affinités lexicales du mot
En conclusion
Enfin, selon la langue que vous apprenez, peut-être y aura-t-il d’autres choses à apprendre systématiquement : pour qui apprend l’allemand, il sera nécessaire de toujours mémoriser le genre des substantifs ; pour qui apprend le russe, il sera nécessaire d’apprendre les verbes dans leurs deux formes (imperfective et perfective), ainsi de suite.
Les mots portent des informations supplémentaires selon les caractéristiques de la langue que vous étudiez ; sachez reconnaître lesquelles sont indispensables afin de bien maîtriser le vocabulaire que vous apprenez.